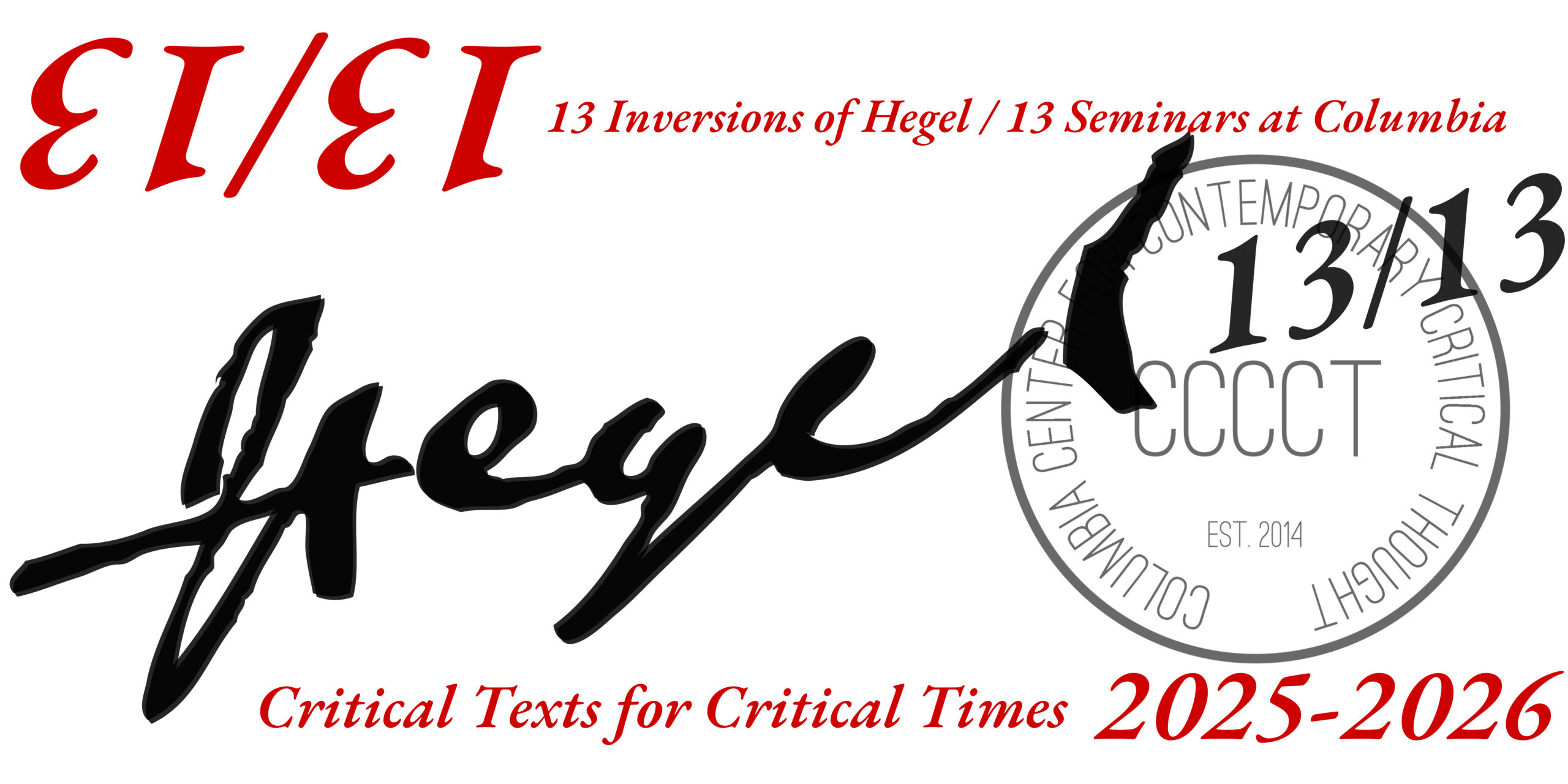UE760 : Les envers de Hegel : de Marx et Lénine à Foucault et Butler
Bernard E. Harcourt, directeur d’études, EHESS – professeur, Columbia University, USA / Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS)
À la fois hégéliens et anti-hégéliens, nombre de grands penseurs politiques des XIXe et XXe siècles ont développé leur philosophie à travers une confrontation avec la philosophie systématique de Hegel. À chaque étape de ses écrits, Marx s’est inspiré d’une dimension de l’œuvre de Hegel – les Principes de la Philosophie du droit dans sa jeunesse, La Phénoménologie de l’Esprit, à laquelle il ne cessera de revenir à partir des Manuscrits économiques et philosophiques de 1844, la Science de la logique dans les Grundrisse. Lénine se consacre à l’étude de la Science de la logique et rédigera ses Cahiers sur Hegel en 1914-1915, qui ont influencé ses théories ultérieures sur l’impérialisme. La philosophie française au XXe siècle s’intéressera à Hegel dès les années 1930, par les lectures d’Alexandre Kojève, le monumental commentaire par Jean Hyppolite, et les interprétations de la dialectique du maître et de l’esclave que pourra en donner Jean-Paul Sartre ; intérêt qui n’a depuis jamais cessé. Foucault en serra un lecteur attentif : un mémoire de fin d’études écrit en 1949 sur « La Constitution d’un transcendantal historique dans La Phénoménologie de l’Esprit de Hegel », sa leçon inaugurale au Collège de France de décembre 1970, L’Ordre du discours. Mais la trace de Hegel peut être lue dans tous ses livres, ses cours, ses entretiens. Judith Butler écrira, à partir de la philosophie française qui travaillera Hegel, sa thèse sur la genèse du sujet désirant en remontant à la Phénoménologie de l’esprit et à son influence sur Kojève, Hyppolite, Sartre, Lacan, Deleuze et Foucault : Subject of Desire, paru en 1987.
S’appuyant sur cette longue histoire, notre séminaire soulèvera l’envers, ce qui n’est pas vu, ou plus vu de Hegel dans la philosophie : ceci, pour penser l’endroit, ce qui est vu, de notre propre approche de la philosophie, de la critique, de la praxis. Il ne s’agit pas d’un « retour à Hegel », au sens où Althusser critiquait la philosophie française d’après-guerre pour s’être rangée du côté de Hegel contre Marx. Cet essai d’Althusser, paru dans La Nouvelle Critique, en novembre 1950, est brillant, et servira de point de départ à notre réflexion.
Notre projet, au contraire, sera de penser l’envers qu’est Hegel dans la philosophie, et non seulement envers, contre Hegel, mais avec Hegel. En ces temps de crise, il est impératif de renouveler la réflexion sur les formes latentes des pensées systématiques et totalisantes.
* * *
Le séminaire est conçu pour être en conversation avec le séminaire public « Hegel 13/13 » qui se déroulera au Columbia Center for Contemporary Critical Thought à Columbia University à New York pendant l’année scolaire 2025-2026, ainsi qu’avec la publication de la traduction française du livre Cooperation: A Political, Economic, and Social Theory par les Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Le séminaire consistera en douze séances de 2 h, réparties sur les deux semestres. La validation de 6 ECTS implique de prendre part aux 24 heures. Le syllabus est en ligne ici, comme celui de l’année dernière (avec tous les enregistrements des séminaires). Le séminaire se réunira (de 16h30 à 18h30) cf. onglet “Lieu et planning“.
Syllabus
Séminaire #1 : Le jeune hégélien Louis Althusser
Date : mardi 21 octobre 2025
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 2.14 Humathèque, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
C’est en 1946-47 qu’on pourrait commencer à étudier les inversions de GWF Hegel dans la pensée du jeune Louis Althusser. Sa vie intellectuelle sera marquée par de vraies acrobaties autour de Hegel, mais tout a commencé après la guerre, avec un petit article qu’il voulait publier en 1946 et son mémoire pour le Diplôme d’études supérieures (DES), ce qui serait l’équivalent aujourd’hui d’un mémoire de M2, qu’il soutient devant Gaston Bachelard en 1947 sous le titre « Du contenu dans la pensée de G.W.F. Hegel » , ainsi que d’un petit compte rendu des cours de d’Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel.
Ces trois écrits de jeunesse du jeune hégélien Louis Althusser, peuvent surprendre. Surprendre parce qu’Althusser se tourne à Hegel pour donner un fondement philosophique à Marx et réconcilier son propre christianisme et sa foi avec sa nouvelle politique révolutionnaire, marxiste. C’est un tout autre Althusser que celui dont nous connaissons si bien depuis *Pour Marx* en 1965 et de cette fameuse « coupure épistémologique » qu’il discerne dans les écrits de Marx en 1845 qui font qu’on doit rejeter le jeune Marx philosophe post-hégélien. Un tout autre Althusser qu’on retrouvera déjà trois ans plus tard en 1950 dans son article « Le Retour à Hegel » qui se terminera sur cette fameuse phrase : « Ce Grand Retour à Hegel n’est qu’un recours désespéré contre Marx, dans la forme spécifique que prend le révisionnisme de la crise finale de l’impérialisme : un révisionnisme de caractère fasciste. »
Dans ce premier séminaire, Bernard E. Harcourt développe la problématique du jeune Althusser : Comment est-il possible que la même dialectique hégélienne, la même forme intellectuelle, le même langage, la même logique, aurait pu donner naissance dix ans après sa mort à la fois aux vieux hégéliens de droite et aux jeunes hégéliens de gauche, y inclus Marx et Engels ? Comment est-ce possible que la pensée hégélienne puisse nourrir à la fois un existentialisme humaniste (pensons à Jean-Paul Sartre), un humanisme réformiste (André Malraux, Albert Camus, Jean Hyppolite, nous le verrons en 1950), un marxisme déterministe, et de la phénoménologie ? Et faut-il donc se libérer de la forme de l’hégélianisme ou plutôt de ces contenus politiques ?
Harcourt reprend cette problématique dans un contexte contemporain pour poser une question urgente aujourd’hui : Comment penser la relation entre la forme et le contenu, entre la théorie et la praxis face à la nouvelle montée de l’extrême droite a travers le monde ?
À lire :
Louis Althusser, « Du contenu dans la pensée de G.W.F. Hegel (1947) », p. 59-238, dans Écrits philosophiques et politiques, t. I, éd. par François Matheron, Paris, Stock-IMEC, 1994 (particulièrement p. 166-217)
Louis Althusser, « L’internationale des bons sentiments (1946) », p. 35-49, dans Écrits philosophiques et politiques, t. I, éd. par François Matheron, Paris, Stock-IMEC, 1994
Louis Althusser, « L’homme, cette nuit (1947) », p. 239-242, dans Écrits philosophiques et politiques, t. I, éd. par François Matheron, Paris, Stock-IMEC, 1994
Project 2025 Presidential Transition Project, Mandate for Leadership: The Conservative Promise (Washington D.C.: The Heritage Foundation, 2023), en-ligne ici: https://static.heritage.org/project2025/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf
En arrière plan :
G.W.F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, ou Droit naturel et science de l’État en abrégé, trad. Robert Derathé, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1975
Karl Marx, Contribution à la Critique de la philosophie de droit de Hegel, ed. et trad. Victor Béguin, Alix Bouffard, Paul Guerpillon, et Florian Nicodème, Pars, les éditions sociales, 2018
Frederick Engels, Ludwig Feuerbach and the Outcome of Classical German Philosophy, ed. C. P. Dutt (New York: International Publishers, 1978 [1888])
Ressources :
Jean-Baptiste Vuillerod, La Naissance de l’anti-hégélianisme. Louis Althusser et Michel Foucault, lecteurs de Hegel (Paris: ENS Éditions, 2022)
* * *
Séminaire #2 : Althusser et Foucault devant Hegel : Le jeune hégélianisme tourne anti-hégélien dans l’après guerre
Date : vendredi 24 octobre 2025
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 3.08, Centre de colloques, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
C’est un tout autre Althusser que l’on retrouve en 1950 dans cet article « Le retour à Hegel. Dernier mot du révisionnisme universitaire » publié en novembre 1950 dans la revue, La nouvelle critique. Agé maintenant de 32 ans, le jeune Althusser se distancie pour la première fois de GWF Hegel.
La question que se pose Althusser dans cet article, ce qui motive l’article, c’est pourquoi la philosophie française qui avait été très hostile à Hegel jusqu’au jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle, tout d’un coup l’adopte et se tourne vers lui au début du XXᵉ siècle. Comme il écrit : « Comment comprendre ce revirement ? »
La réponse d’Althusser : pour la même raison que Hegel servait à la féodalité prussienne à réprimer et écraser la classe bourgeoise qui se soulevait au XIXᵉ siècle en Allemagne. Les écrits de Hegel, particulièrement sur l’État, servent à la bourgeoisie française en 1950 à écrase et réprimer la classe ouvrière montante. C’est le même pari, la même ambition, comme il dit, « de mettre la classe montante en servitude. » Et là il attaque directement Raymond Aron, Jean Hyppolite, et les philosophes français, en les accusant en effet d’agir comme Mussolini et les fascistes à travers l’Europe, d’utiliser la pensée hégélienne pour asservir la classe ouvrière. C’est très brutal, c’est très violent. Althusser est en train de parler du fascisme et de l’autoritarisme prussien, et en fait il met à équivaut, sur les mêmes pieds, des philosophes et des penseurs français comme Aron et Hippolyte. C’est donc une « opération » « fasciste » qu’il attaque.
Dans cette deuxième séance, nous continuerons l’analyse avec l’anti-hégélianisme du jeune Louis Althusser circa 1950, avec une interlude pour introduire le jeune hégélien Michel Foucault, une autre surprise.
À lire :
Michel Foucault, La constitution d’un transcendantal historique dans la Phénoménologie de l’esprit de Hegel. Mémoire du diplôme d’études supérieures de philosophie (Paris, Vrin: 2024 [1949])
Louis Althusser, « Le retour à Hegel. Dernier mot du révisionnisme universitaire » [1950], dans Écrits philosophiques et politiques, t. I, éd. par François Matheron, Paris, Stock-IMEC, 1994, p. 243-260
En arrière plan :
G.W.F. Hegel, La Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean Hyppolite, en deux volumes (Paris : Aubier, 1939)
Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, trad. Franck Fischbach, Paris, Vrin, 2007.
Ressources :
Jean-Baptiste Vuillerod, La Naissance de l’anti-hégélianisme. Louis Althusser et Michel Foucault, lecteurs de Hegel (Paris: ENS Éditions, 2022)
* * *
Séminaire #3 : Guillaume Rouleau présente sur Alexandre Kojève et Jean Hyppolite
Date : mardi 4 novembre 2025
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 2.14 Humathèque, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
Pour cette troisième séance, Guillaume Rouleau, doctorant à l’EHESS, dont les recherches portent sur la notion d’idéologie dans la philosophie française des années 1950 à 1970, présentera le commentaire de G.W.F. Hegel par Alexandre Kojève, donné lors de son séminaire à l’École pratique des hautes études de 1933 à 1939, et en partie publié sous le titre d’Introduction à la lecture de Hegel en 1947. La présentation de Rouleau s’arrêtera sur l’un des passages les plus importants de La Phénoménologie de l’esprit, sur les étapes constitutives de la conscience de soi : le désir, la lutte, la reconnaissance, et ce qui a pu être désigné comme dialectique du maître et de l’esclave ; ainsi que sur des développements de la conscience de soi dans l’Introduction à la lecture de Hegel. Si Hegel pose les termes d’un rapport de domination, Kojève pensera autrement ces termes, notamment par Marx, des marxismes, dont celui, surtout, de lutte.
À lire :
G.W.F. Hegel, « (B) Conscience de soi », in La Phénoménologie de l’esprit, tome 1, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier, 1939, pp. 145-194 ; voir aussi « La vérité de la certitude de soi-même », in Phénoménologie de l’esprit, trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Aubier, 1991.
Alexandre Kojève, « En guise d’introduction », in Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur « La Phénoménologie de l’esprit », professées de 1933 à 1939 à l’Ecole des Hautes Études, réunies et publiées par Raymond Queneau, Paris, Gallimard, 1947, pp. 11-34.
—, « Résumé des six premiers chapitres de La Phénoménologie de l’esprit », op. cit., pp. 161-195.
Jean Hyppolite, « De la conscience de soi naturelle à la conscience de soi universelle », in Genèse et structure de la phénoménologie de l’esprit de Hegel, Tome 1, Paris, Aubier, Montaigne, 1946, pp. 139-208.
En arrière plan :
Karl Marx, « Critique de la dialectique de Hegel et de sa philosophie en général », in Manuscrits de 1844, présentation, traduction et notes de Emile Bottigelli, Paris, Éditions sociales, 1972.
—, « Préface », in Contribution à la critique de l’économie politique, trad. Maurice Husson et Gilbert Badia, Paris, Éditions sociales, 1972.
* * *
Séminaire #4 : Lénine et Marx devant Hegel, une nouvelle pratique philosophique. Louis Althusser en 1969.
Date : vendredi 7 novembre 2025
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 3.08, Centre de colloques, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
Non pas « renversement » et non plus simplement « circularité », mais « décorticage », « épurage », « extraction », « transformation », et éventuellement l’invention d’ « une nouvelle pratique philosophique » : dans ses écrits de 1965-1969 sur Marx et Lénine devant Hegel, Louis Althusser élabore au moins cinq autres modèles pour remplacer la métaphore du « renversement » que Marx aurait opéré sur la pensée de Hegel.
Reprenant ses propres analyses antérieures, faisant plusieurs « renversements » lui-même, grâce à une autocritique, Althusser nous offre plusieurs manières de penser aux « envers de Hegel », et nous laisse à la fin avec une vision de ce que pourrait être une nouvelle pratique de la philosophie : de tracer des lignes de démarcation à l’intérieur du domaine théorique et de prendre parti dans la lutte sociale.
La relecture de Lénine et de ses Cahiers sur la dialectique de Hegel serait fondamentale pour réorienter la philosophie contemporaine, non seulement vers une philosophie de la praxis mais vers une pratique philosophique transformative.
Dans cette quatrième séance, nous retournerons au Louis Althusser des années 1965-69, son autocritique, et ses derniers écrits sur Hegel, Marx, et Lénine.
À lire :
Louis Althusser, Pour Marx (Paris: Maspéro, 1965)
Louis Althusser, Lénine & la philosophie, suivi de Marx & Lénine devant Hegel (Paris: Maspéro, 1975)
En arrière plan :
Lénine, Cahiers sur la dialectique de Hegel, trad. Henri Lefebvre et Norbert Guterman (Paris, Gallimard, 1967 [1938])
Ressources :
Kevin B. Anderson, Lenin, Hegel and Western Marxism: A Critical Study, 2nd edition (Chicago: Haymarket Books, 2023).
* * *
Séminaire #5 : Simone de Beauvoir et Le Deuxième Sexe (1949)
Date : mardi 6 janvier 2026
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 2.14 Humathèque, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
Début juillet 1940. La France vient de capituler. Les Allemands occupe Paris. Simone de Beauvoir se rend à la Bibliothèque nationale de France et se plonge dans la lecture de La Phénoménologie de l’esprit de Hegel.
Pendant plusieurs mois, Beauvoir passe les après-midis à lire Hegel. Cette confrontation, particulièrement avec la dialectique dite « du maître et de l’esclave », laisse une trace indélébile sur son œuvre, Le Deuxième Sexe, publié en 1949. Reprenant la dialectique de sa propre façon, Beauvoir caractérise la femme non pas tellement comme une esclave de l’homme, mais liée par des relations féodales similaire à la vassalité.
Beauvoir convertit la lecture hégélienne de Kojève, celle d’une « anthropologie phénoménologique » centrée sur la reconnaissance humaine et la lutte des classes, en une analyse politico-économique centrée sur la nécessité du travail et de l’indépendance financière de la femme.
Dans ce séminaire, nous analysons la lecture de Simone de Beauvoir de Hegel et les implications pour notre situation politique aujourd’hui. Nous lirons Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir en conversation avec la dialectique maître-esclave de Hegel.
À lire :
Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe (Paris: Gallimard, 1949)
Simone de Beauvoir, La Force de l’âge (Paris, Gallimard, 1960)
Simone de Beauvoir, Journal de guerre. Septembre 1939-janvier 1941 (Paris, Gallimard, 1990)
En arrière plan :
G.W.F. Hegel, « (B) Conscience de soi », in La Phénoménologie de l’esprit, tome 1, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier, 1939, pp. 145-194.
Ressources :
Kimberly Hutchings, « Beauvoir and Hegel », p. 187-197, in Laura Hengehold and Nancy Bauer, eds. A Companion to Simone de Beauvoir (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2017).
Jean-Baptiste Vuillerod, « Le maître et la vassale. Hegel, Beauvoir en miroir », Simone de Beauvoir Studies 34 (2023) 100–120.
Marie-Andrée Charbonneau, « Le Deuxième Sexe et la philosophie: Maître, esclave, ou …? Le Cas Simone De Beauvoir », Simone de Beauvoir Studies, 2000-2001, Vol. 17, Beauvoir in the New Millennium (2000-2001), pp. 7-19
Susan F. Buck-Morss, Hegel, Haiti, and Universal History (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009)
Alain Badiou, « Maîtres et esclaves chez Hegel », Sud/Nord 2016/2 n° 27, pages 35 à 47, Éditions érès.
* * *
Séminaire #6 : Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, et Simone de Beauvoir
Date : vendredi 9 janvier 2026
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 3.08, Centre de colloques, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Résumé :
G.W.F. Hegel ouvre son grand livre La Science de la logique (1812) avec une discussion de l’être et du néant, dialectique qui mène d’abord au concept du devenir, avant de déboucher sur toute sa philosophie de la nature et de l’esprit, et éventuellement l’esprit absolu. Jean-Paul Sartre, par contre, prend comme titre pour sa première grande œuvre philosophique L’Être et le néant (1943), mais reste fixé dans ce néant angoissant qui représente notre existence.
Critique de l’« optimisme » de Hegel—optimisme épistémologique, optimisme ontologique—Sartre demeurera aussi absorbé dans la dialectique hégélienne du maître et de l’esclave. Il la reprenant dans presque tous ses écrits depuis L’Être et le néant à ses Réflexions sur la question juive (1946), ses Cahiers pour une morale (1947-1948), sa Critique de la raison dialectique (1960), sa préface aux Damnés de la terre de Fanon, etc.
On pourrait dire, avec Ruud Welten, que « lorsqu’il s’agit de la philosophie de l’autre chez Sartre, l’influence de la philosophie maître-esclave de Hegel est immense : Sartre comprend la relation entre l’être-pour-soi et l’être-en-soi comme une relation dialectique. »
Frantz Fanon s’attaque à cette dialectique hégélienne du maître et de l’esclave dans son livre de 1952 Peau noir, masques blancs, et l’actualise pour la situation française coloniale. Inspirant Sartre, Fanon réoriente la théorisation de la lutte vers une praxis de la violence.
Alors que Simone de Beauvoir (comme nous avions vu au dernier séminaire) modifie, utilise, et remet sur ses pieds la dialectique maître-esclave en la retournant sur le modèle original de la vassalité et la féodalité, Sartre et Fanon par contre critiquent la dialectique hégélienne comme ne reflétant pas la réalité – mais ils la reprennent pour leur propre projet, dans les mots de Fanon, « d’amener l’homme à être actionnel. »
Dans ce séminaire, Bernard E. Harcourt développe l’engagement de Sartre et Fanon, en discussion avec le dernier séminaire sur Beauvoir, pour nous interroger sur leur pertinence aujourd’hui.
À lire :
En arrière plan :
G.W.F. Hegel, « (B) Conscience de soi », in La Phénoménologie de l’esprit, tome 1, trad. Jean Hyppolite, Paris, Aubier, 1939, pp. 145-194.
Ressources :
Brandon Hogan, “Frantz Fanon’s Engagement With Hegel’s Master-Slave Dialectic,” Africology: The Journal of Pan African Studies, Volume 11, no. 8 (2018): 16-32.
James Schmidt, “Lordship and Bondage in Merleau-Ponty and Sartre,” Political Theory 7, no. 2 (1979): 201–27.
* * *
Séminaire #7 : Judith Butler
Date : mardi 17 mars 2026
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle 2.14 Humathèque, Campus Condorcet, Cours des humanités 93300 Aubervilliers
Zoom: https://columbiauniversity.zoom.us/j/94272888066?pwd=VkdKeWNNMHh0MjRFWXpFVkdHSGFWUT09
Séminaire #8 : Gilles Deleuze, avec Jean-Baptiste Vuillerod
Date : vendredi 20 mars 2026
Heure : 16h30 à 18h30 (Paris GMT+1)
Lieu : salle BS1_05/BS1_28, EHESS, 54 bd Raspail, Paris
Zoom: https://columbiauniversity.zoom.us/j/94272888066?pwd=VkdKeWNNMHh0MjRFWXpFVkdHSGFWUT09
~~~
Validation
La validation du séminaire se fera de la façon suivante :
- Il faut s’enregistrer au séminaire ici : https://participations.ehess.fr ;
- Il faut remplir le formulaire de validation sur Google Forms avant le 1 décembre 2025 ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWKvpJHAL4HBRkPgmbF5TqZl6GLhYNTJn878dHlpNpcCea7w/viewform?usp=header
- Il faut signer le cahier de présence pour chaque séance (et me rappeler de le faire passer si nécessaire) ;
- Il faut écrire un travail de recherche de 10 pages double-spaced (~2500 mots). Pour ce travail, choisissez un thème à développer lié au séminaire (e.g. sur le travail d’un.e philosophe; sur votre théorie critique des inversions de Hegel) ;
- Il faut rendre, avant le 5 juin 2026, votre travail écrit par email envoyé à bernard.harcourt@ehess.fr et cccct@law.columbia.edu ;
- sur votre travail, il faut indiquer : votre nom ; votre master ; et le courriel de l’administrateur.trice de votre master ; et
- vous devez m’envoyer la fiche de validation de votre master, remplie (sauf pour la note et le commentaire !).
Je me réjouis de vous lire !